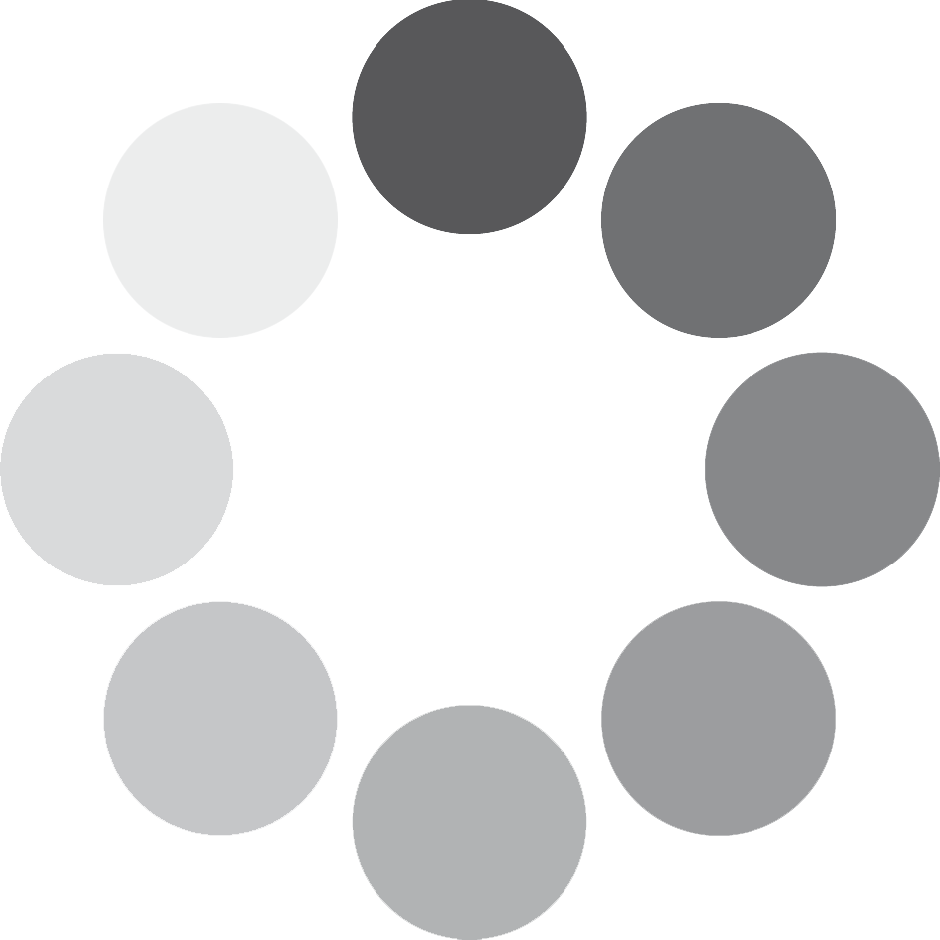Arrêt de travail et DSN
11 octobre 2024
Quand un salarié est dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle, son contrat de travail peut être suspendu temporairement. Cette suspension peut être due à un arrêt de travail (maladie, accident, maternité, paternité), ou à d’autres motifs comme le chômage partiel, le congé sans solde ou l’invalidité. Dans tous les cas, la gestion de cette suspension via la DSN (déclaration sociale nominative) est une étape incontournable — et parfois redoutablement piégeuse — pour les entreprises, les experts-comptables et les avocats.
Déclaration des arrêts de travail et suspensions en DSN : ce qu’il faut savoir
La DSN est le seul vecteur de transmission des arrêts de travail aux organismes sociaux. Elle permet d’alerter la CPAM, la MSA, l’URSSAF et d’autres interlocuteurs de la suspension du contrat de travail. Toute suspension pouvant donner lieu à une indemnisation de l’assurance maladie doit impérativement être déclarée via la DSN, et ce, dès que l’employeur en a connaissance — pas uniquement lorsqu’elle a un impact sur la paie.
Un arrêt de travail déclaré en DSN comprend plusieurs données clés :
- Le motif de l’arrêt : maladie, accident du travail, maternité, paternité, maladie professionnelle, temps partiel thérapeutique…
- Les dates : dernier jour travaillé, début de l’arrêt, fin prévisionnelle et date de reprise effective
- Le statut de subrogation : si l’employeur perçoit les IJSS à la place du salarié
- Le nombre de jours travaillés avant l’arrêt
Les omissions, erreurs ou retards sont immédiatement sanctionnés — par un blocage administratif ou un préjudice pour le salarié. Et ce sont souvent les entreprises qui en paient le prix, à la fois humainement et juridiquement.
Temps partiel thérapeutique : un cas à part, mal maîtrisé
Le temps partiel thérapeutique permet au salarié de reprendre progressivement son poste avec un aménagement de son temps de travail. Cette configuration implique une perte de salaire, partiellement compensée par l’assurance maladie.
En DSN, il faut préciser :
- La période exacte de temps partiel thérapeutique
- Le montant de la perte de salaire
Attention : la DSN ne remplace pas encore complètement la DSIJ (déclaration de situation et d’indemnisation des IJ) dans ce cas. Il faut donc gérer les deux dispositifs en parallèle, sous peine d’anomalies de traitement.
Subrogation : un levier à double tranchant
La subrogation permet à l’employeur de percevoir les indemnités journalières à la place du salarié. C’est pratique sur le papier, mais c’est une source fréquente d’erreurs.
Si la subrogation est choisie, elle doit être formalisée, déclarée dans la DSN événementielle et reprise dans la DSN mensuelle. Sinon, l’entreprise devra avancer les salaires sans jamais être remboursée.
À prévoir impérativement :
- Une clause dans le contrat de travail ou la convention collective
- Une procédure interne de suivi
- Un paramétrage correct du logiciel de paie
Autres suspensions du contrat de travail à déclarer en DSN
Toutes les suspensions n’ouvrent pas droit à une indemnisation, mais doivent néanmoins être déclarées. Il s’agit notamment de :
- Invalidité
- Chômage intempéries
- Congé de présence parentale
- Congé de proche aidant
- Congés spécifiques à la fonction publique (détachement, mise à disposition, etc.)
La DSN doit mentionner les dates de début et de fin, ainsi que le type de suspension. Cela permet une cohérence des droits sociaux et une mise à jour fiable du dossier salarié.
Sanctions administratives : l’administration ne pardonne rien
Les organismes sociaux (URSSAF, CPAM, MSA…) disposent d’outils de contrôle automatiques. Si une DSN est mal remplie, envoyée hors délai ou incohérente avec la réalité, les conséquences sont immédiates :
- Retards ou absence de versement des IJSS
- Rejets de dossiers par les caisses
- Redressements URSSAF
- Mise en cause de l’employeur devant le conseil des prud’hommes
De plus en plus de contentieux sociaux naissent de mauvaises DSN. Et les juges ne sont pas tendres avec les employeurs négligents.
Bonnes pratiques : que doit mettre en place l’entreprise ?
Voici les incontournables pour une gestion sécurisée des arrêts de travail en DSN :
- Réception immédiate du volet 3 de l’arrêt et signalement sous 5 jours maximum
- Double vérification des données : dates, motif, subrogation, etc.
- Transmission immédiate via logiciel de paie certifié DSN
- Contrôle régulier des retours d’anomalies (CRAMIF, Net-entreprises, etc.)
- Mise en place d’un circuit interne de validation entre RH, paie et direction
- Archivage rigoureux des arrêts et preuves de transmission
Ne faites pas confiance aveuglément à votre logiciel de paie
Tous les logiciels ne se valent pas. Certains n’intègrent pas tous les cas (temps partiel thérapeutique, prolongation successive, arrêts fractionnés, etc.). D’autres sont mal paramétrés ou peu ergonomiques.
Il est essentiel que le responsable paie ou le cabinet d’expertise comptable maîtrise la logique DSN, au-delà de l’interface logicielle. Un audit régulier du paramétrage DSN est recommandé.
En résumé : arrêts de travail et DSN, un enjeu RH et juridique majeur
La déclaration des arrêts de travail via la DSN n’est pas une simple formalité. C’est une procédure technique, juridique et administrative, où l’erreur ne pardonne pas. Ce n’est pas à l’administration de faire preuve de pédagogie. C’est à l’employeur d’anticiper, vérifier, corriger.
En cas de doute, mieux vaut consulter un expert en droit social ou en DSN que de laisser les choses en roue libre. Car les conséquences, elles, ne sont jamais virtuelles : IJSS bloquées, salariés mécontents, URSSAF sur le dos, prud’hommes à l’horizon.