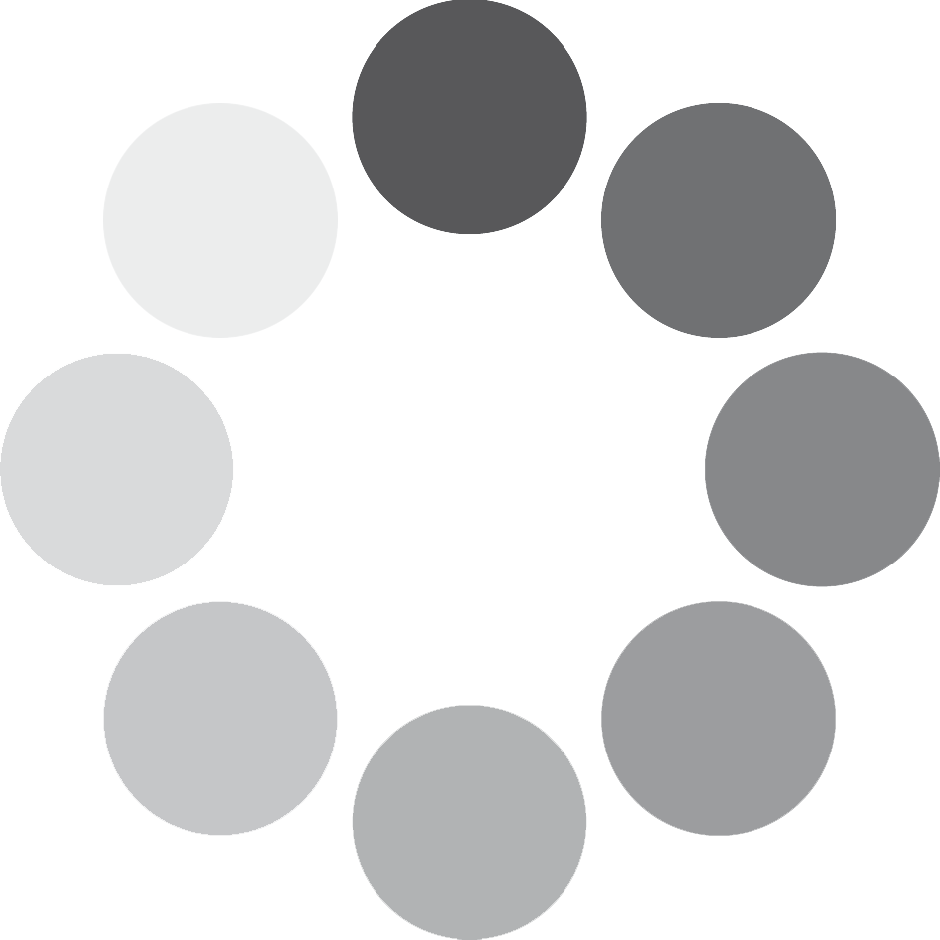Prime de risque au travail : fonctionnement, conditions, recours et montants
6 janvier 2025
La prime de risque constitue une compensation financière destinée aux salariés exposés à des conditions de travail dangereuses, insalubres ou pénibles. Pourtant, son versement n’est ni automatique ni encadré par le code du travail, ce qui laisse place à des disparités d’application, notamment entre le secteur privé et la fonction publique. Voici ce que les employeurs et les salariés doivent absolument savoir.
Qu’est-ce que la prime de risque et dans quels secteurs s’applique-t-elle ?
Cette prime s’adresse aux salariés dont les fonctions comportent un danger physique ou des conditions particulièrement pénibles. Elle est souvent versée dans les domaines suivants :
- bâtiment : les travaux en hauteur (échafaudages, toitures, pylônes) exposent les ouvriers à des risques de chute graves.
- santé et sécurité : les personnels évoluant dans des structures comme les hôpitaux psychiatriques, les unités pour malades difficiles (UMD) ou les établissements pénitentiaires sont confrontés à des risques d’agression ou de contamination.
- industrie : certaines machines (scies à ruban, presses rotatives, cisailles…) ou produits utilisés (solvants, hydrocarbures, poussières métalliques) peuvent entraîner des accidents ou maladies professionnelles.
- recherche : les manipulations de produits toxiques en laboratoire (produits caustiques, inflammables ou cancérogènes) justifient une prime compensatoire.
Absence d’encadrement légal : une décision à la discrétion de l’employeur
Contrairement à d’autres éléments de la rémunération, la prime de risque n’est pas encadrée par un texte de loi. Elle ne figure pas dans le code du travail et relève donc du bon vouloir de l’employeur. Toutefois, elle peut être prévue dans trois cas :
- par contrat de travail individuel,
- par convention collective,
- par usage de la profession, comme c’est souvent le cas dans le BTP.
Un salarié peut aussi en faire la demande directe s’il considère que ses tâches l’exposent à un danger avéré. Dans ce cas, l’employeur reste libre d’accepter ou non, mais son refus pourrait être contesté si un usage ou un texte collectif impose ce versement.
Modalités de versement : une prime mensuelle intégrée à la rémunération
La prime de risque, si elle est accordée, fait partie intégrante de la rémunération. Elle doit figurer sur le bulletin de paie chaque mois. Elle ne peut pas être versée de manière exceptionnelle ou ponctuelle. Le montant est fixé librement par l’employeur ou la convention collective, sans plancher ni plafond imposé.
Recours en cas de non-versement
Lorsque la prime est prévue par un texte (contrat, convention, usage), l’absence de versement constitue une faute de l’employeur. Le salarié peut agir :
- En envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception à l’employeur pour demander un rappel de salaire.
- En saisissant le Conseil de prud’hommes, si l’employeur refuse de régulariser.
Le délai pour agir est de 3 ans, y compris après avoir quitté l’entreprise. Cette prime est incluse dans le calcul de l’indemnité de congés payés, de préavis de licenciement et dans l’assiette des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu.
Cas particulier des agents publics : 2 indemnités encadrées et cumulables
Dans la fonction publique, les agents peuvent bénéficier de l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants (ITDIIS), ainsi que de l’indemnité forfaitaire de risque (IFRR). Contrairement au secteur privé, ces primes sont strictement encadrées par des arrêtés ministériels.
L’indemnité ITDIIS : montants et exemples concrets
L’ITDIIS est versée selon 3 catégories de risque, déterminées en fonction des tâches effectuées :
- 1re catégorie (risques physiques graves) : manipulation d’explosifs, interventions sur lignes haute tension, travaux sur toitures, usage de machines dangereuses… Montant de base : 1,03 € par demi-journée, avec des majorations selon les tâches (jusqu’à 2,06 €).
- 2e catégorie (intoxication, contamination) : désamiantage, utilisation de produits chimiques en espace clos, nettoyage de locaux infectés… Montants de base : 0,31 € à 0,16 €.
- 3e catégorie (travaux salissants ou incommodes) : curage de canalisations, archivage poussiéreux, entretien de moteurs… Montant : 0,15 € à 0,08 €.
Les montants doivent être multipliés par le nombre de demi-journées réellement effectuées.
L’indemnité forfaitaire de risque (IFRR) : secteurs éligibles
L’IFRR concerne les agents travaillant en permanence dans certains établissements sensibles, même s’ils ne sont pas titulaires :
- services de soins accueillant des personnes détenues (hôpitaux publics de Fresnes, CHU de Lille, Marseille, Bordeaux, Rennes, etc.) ;
- services médico-psychologiques régionaux (suivi psychiatrique en milieu carcéral) ;
- unités pour malades difficiles (UMD) ;
- structures médico-pénitentiaires désignées par arrêté interministériel.
L’affectation doit être permanente et dans un établissement répertorié. Un annuaire officiel permet de vérifier l’éligibilité.
Ce que les employeurs doivent anticiper
Les employeurs du secteur privé n’ont pas d’obligation légale, mais ignorer l’exposition au risque de certains salariés peut exposer à un contentieux, notamment si un usage est établi dans l’entreprise ou la branche. Il est donc conseillé de :
- formaliser les conditions d’attribution dans le contrat ou un avenant,
- s’appuyer sur les classifications de postes à risque,
- intégrer la prime à la politique de prévention des risques professionnels.
Dans le public, la réglementation est claire, mais son application exige une veille attentive sur les textes en vigueur (décrets, arrêtés ministériels, conventions avec les ARS…).
Pour aller plus loin
Vous êtes employeur et vous vous interrogez sur l’exposition aux risques dans votre structure ? N’hésitez pas à faire auditer vos processus RH et à vérifier les fiches de paie. Un audit des postes à risque peut aussi être une démarche préventive utile.