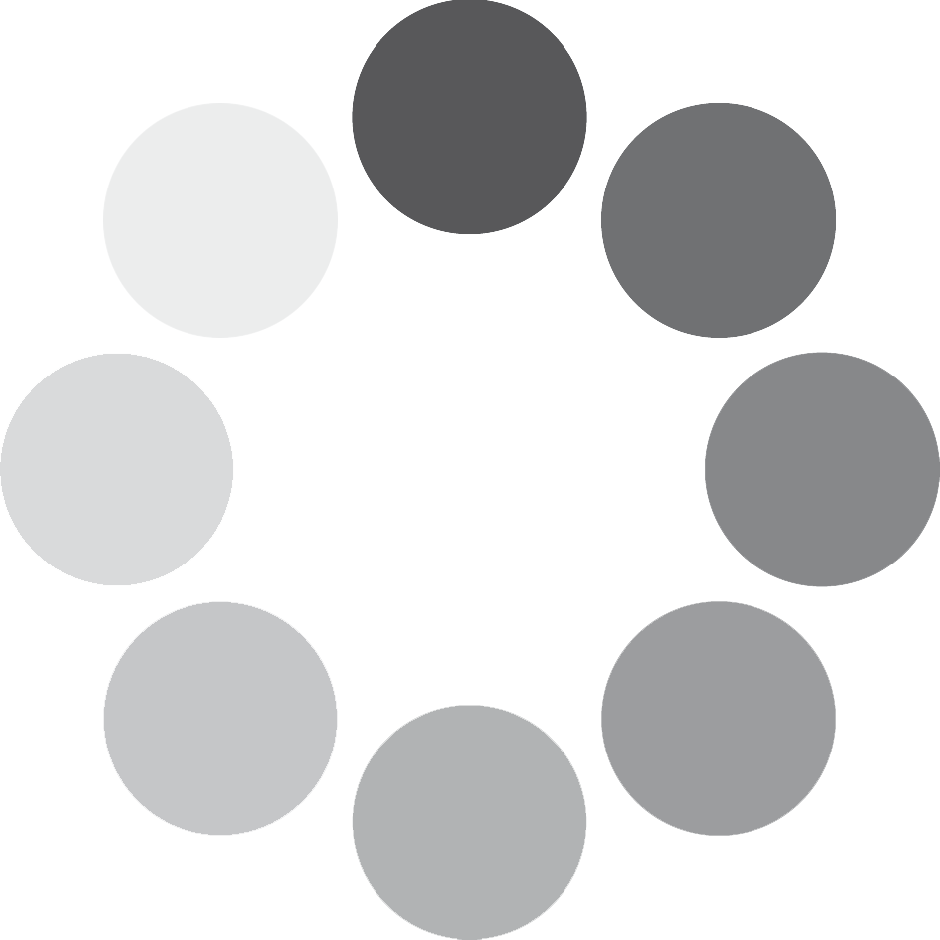Prime d’insalubrité : conditions d’attribution et montants
6 octobre 2024
Dans la fonction publique, il existe une indemnité spécifique destinée aux agents exposés à des environnements de travail dégradés : l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, plus connue sous le sigle ITDIIS. Cette compensation est censée couvrir les risques réels et les désagréments importants liés à certaines missions. Pourtant, entre le formalisme administratif, les barèmes dérisoires et l’oubli organisé du secteur privé, le traitement de cette question laisse … songeur.
Une indemnité réservée aux agents publics… ou presque
L’ITDIIS concerne les agents des 3 fonctions publiques (État, territoriale, hospitalière), qu’ils soient titulaires, stagiaires ou contractuels, à condition que la dangerosité ou l’insalubrité de leurs missions soit avérée, et que la délibération locale le permette. Le fondement juridique repose sur le décret n°67-624 du 23 juillet 1967 pour la fonction publique d’État, décliné ensuite pour les fonctions territoriales et hospitalières.
En clair, si un agent travaille dans un environnement infesté de moisissures, manipule des substances hautement toxiques ou encore collecte des déchets, il peut prétendre à cette prime. Cela inclut aussi les expositions à l’amiante ou aux rayonnements ionisants.
Catégorisation des risques et calcul de l’ITDIIS
Avant toute chose, il faut déterminer la nature du risque encouru, qui se décline en 3 catégories :
- La première, correspondant aux risques physiques avec potentiels dommages corporels.
- La deuxième, liée aux risques chimiques ou biologiques (empoisonnement, contamination).
- La troisième, qui regroupe les tâches inconfortables, salissantes ou simplement pénibles.
À chaque catégorie correspond un tarif de base, fixé par arrêté ministériel. Depuis le 1er janvier 2022, ces montants sont les suivants :
- 1,03 € pour la première catégorie
- 0,31 € pour la deuxième
- 0,15 € pour la troisième
Ces montants, déjà très faibles au regard des risques encourus, sont multipliés par 2 éléments :
- Le taux attribué à la tâche, variant de 0,5 à 2
- Le nombre de demi-journées réellement effectuées dans ces conditions
Le résultat, souvent symbolique, est censé compenser des expositions qui peuvent avoir des conséquences graves sur la santé à long terme. Autant dire que le système repose plus sur une logique administrative que sur une réelle volonté de protection sociale.
Des tableaux officiels, une rigueur bureaucratique… et des oublis
L’arrêté du 18 mars 1981 liste précisément les missions éligibles à chaque catégorie. On y trouve par exemple dans la première catégorie : les travaux en galeries, les égouts, l’exposition à des agents pathogènes, les manipulations d’objets lourds ou instables. La deuxième inclut les manipulations de produits toxiques comme le mercure, le plomb, le benzène ou les dérivés arsenicaux. La troisième concerne des missions comme l’abattage d’animaux, le tri de chiffons, la collecte d’ordures ou encore les travaux dans les égouts.
Cette codification est complétée par l’arrêté du 23 juillet 1947, qui impose aux employeurs publics de mettre à disposition des douches individuelles pour les agents exposés, avec un temps de douche compris entre 15 et 60 minutes, considéré comme temps de travail.
démarches à suivre en cas de non-versement
Si vous ne percevez pas cette indemnité alors que vous pensez y être éligible, le premier réflexe est de demander un rendez-vous avec votre service des ressources humaines ou votre gestionnaire paie. Il est également indispensable de consulter votre arrêté individuel d’attribution pour vérifier les modalités de versement. En cas de refus injustifié, vous pouvez saisir le médiateur de votre collectivité ou porter l’affaire devant le tribunal administratif.
Et le secteur privé ?
Dans le secteur privé, il n’existe aucune obligation légale de verser une prime d’insalubrité. Ce silence du Code du travail en dit long sur la hiérarchie implicite entre les vies humaines selon qu’elles dépendent ou non de l’État. La mise en place d’une telle prime relève uniquement de la négociation collective ou d’un accord d’entreprise. C’est donc à l’employeur, ou à la convention collective, de décider de son existence… et de son montant.
À noter cependant : même en l’absence de prime, l’employeur reste tenu de fournir des douches aux salariés effectuant des tâches insalubres ou salissantes, selon les dispositions de l’arrêté du 23 juillet 1947. Le temps de douche est rémunéré, et sa durée doit être encadrée par un règlement intérieur.
Quelques exemples de travaux considérés comme insalubres
Voici un aperçu non exhaustif des tâches listées dans les arrêtés précités :
- traitement du plomb et de ses composés (alliages, ébarbage, polissage, création de batteries)
- manipulation de mercure, arsenic, benzène, dinitrophénol, amines aromatiques
- travail avec émaux, pigments en poudre, colorants, peintures industrielles
- travaux de fonderie, concassage de ciment, manutention de charbon
- collecte et traitement des ordures, égouts, laboratoires avec animaux
- abattage, équarrissage, contact avec fluides de coupe ou lubrifiants
- entretien de fours, chaudières, cheminées, en contact avec les suies
Ces tâches ne sont pas uniquement désagréables : elles sont aussi potentiellement toxiques, voire cancérigènes. Pourtant, la compensation prévue par l’administration reste à des années-lumière de l’exposition réelle.